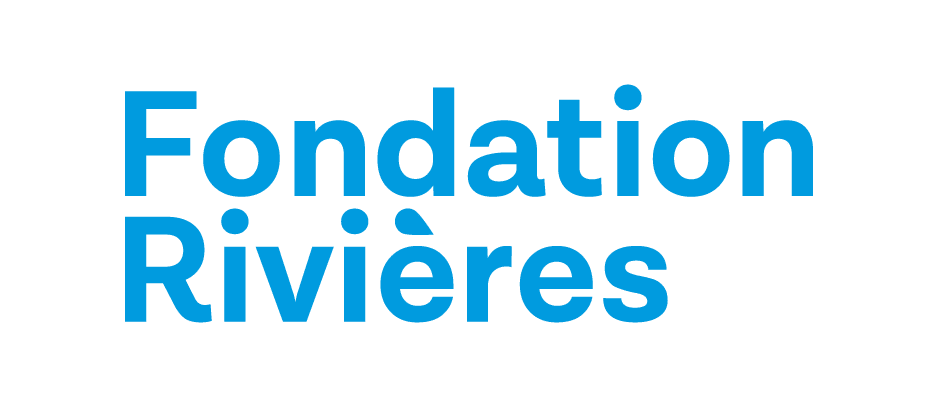Un accès aux berges verrouillé au Québec
Plus de 98% des rives des rivières et des lacs sont inaccessibles au public, en grande partie à cause de la privatisation croissante des berges. Si nous ne faisons rien, cela risque d’empirer, mais bonne nouvelle : il est encore temps d’agir. D’autres l’ont fait ailleurs dans le monde et on peut très bien appliquer ces solutions chez nous !
Plus de 98% des rives des rivières et des lacs sont inaccessibles au public. Il est encore temps d’agir !
Cartographie des rivages : l’état réel de l’accès aux berges au Québec
Les chercheurs Sébastien Rioux et Rodolphe Gonzalès, respectivement professeurs aux départements de géographie de l’Université de Montréal (UdeM) et de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) ont rendu public les détails des premiers résultats de leur cartographie de l’enclavement des plans d’eau au Québec, un travail colossal.
Les chercheurs ont développé un algorithme qui croise les données du cadastre (4 millions de lots) et celles de l’hydrographie (3,8 millions de lacs et segments de rivières). À partir de ces données, Ils ont identifié plus de 93 500 lots riverains répartis dans 104 municipalités dans 15 régions administratives. Ces municipalités ont répondu à un questionnaire et confirmé le taux d’enclavement.
La Fondation Rivières a collaboré avec les chercheurs qui ont obtenu une subvention d’engagement partenarial du Conseil de recherches en sciences humaines du gouvernement du Canada.
Découvrez sur cette carte interactive quelques-uns des lacs les plus représentatifs de l’enclavement des eaux publiques par la propriété privée.
Les chercheurs Sébastien Rioux et Rodolphe Gonzalès, respectivement professeurs aux départements de géographie de l’Université de Montréal (UdeM) et de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) ont rendu public les détails des premiers résultats de leur cartographie de l’enclavement des plans d’eau au Québec, un travail colossal.
Ils ont développé un algorithme qui croise les données du cadastre (4 millions de lots) et celles de l’hydrographie (3,8 millions de lacs et segments de rivières). À partir de ces données, Ils ont identifié plus de 93 500 lots riverains répartis dans 104 municipalités dans 15 régions administratives. Ces municipalités ont répondu à un questionnaire et confirmé le taux d’enclavement.
Découvrez sur cette carte intéractive quelques-uns des lacs les plus représentatifs de l’enclavement des eaux publiques par la propriété privée.
Témoignages: nous sommes tous concernés
Dans le cadre de sa démarche sur l’accès public aux berges, la Fondation Rivières a recueilli une série de témoignages auprès de ses membres et partenaires à travers le Québec.
Ces récits montrent que l’accès légal ne garantit pas l’accès réel pour toutes et tous — et que même des accès publics ne sont plus accessibles. De fait, il y a si peu d’accès public aux berges que cela entraîne un surachalandage dans certaines régions. En réaction, des municipalités imposent des tarifs excessifs ou adoptent des règlements qui réservent les accès publics aux résidents, voire interdisent le stationnement. Ces mécanismes dissuasifs doivent être interdits ou, à tout le moins, encadrés.
Nous avons regroupé ces témoignages par type de problème rencontré. Vous pouvez les parcourir grâce à l’outil d’accordéon.
Dans le cadre de sa démarche sur l’accès public aux berges, la Fondation Rivières a recueilli une série de témoignages auprès de ses membres et partenaires à travers le Québec.
Ces récits montrent que l’accès légal ne garantit pas l’accès réel pour toutes et tous — et que même des accès publics ne sont plus accessibles.
Nous avons regroupé ces témoignages par type de problème rencontré. Vous pouvez les parcourir grâce à l’outil d’accordéon.
À vous la parole

« J’allais pendant plusieurs années me baigner au lac du Mont Gale, à Bromont. La plage était déjà interdite aux non résidents, alors quelques personnes se baignaient de l’autre côté du lac, dans un endroit accessible et tranquille et c’était toléré [...]. Il y a trois ans, l’accès aux non-résidents a été complètement interdit, même en payant un droit d’entrée. Les gardiens de la plage m’ont menacé d’appeler la police si je ne quittais pas les lieux immédiatement ! »
Marie, nageuse en Estrie

Je n'ai pas du tout accès à ma rivière ou à mon lac
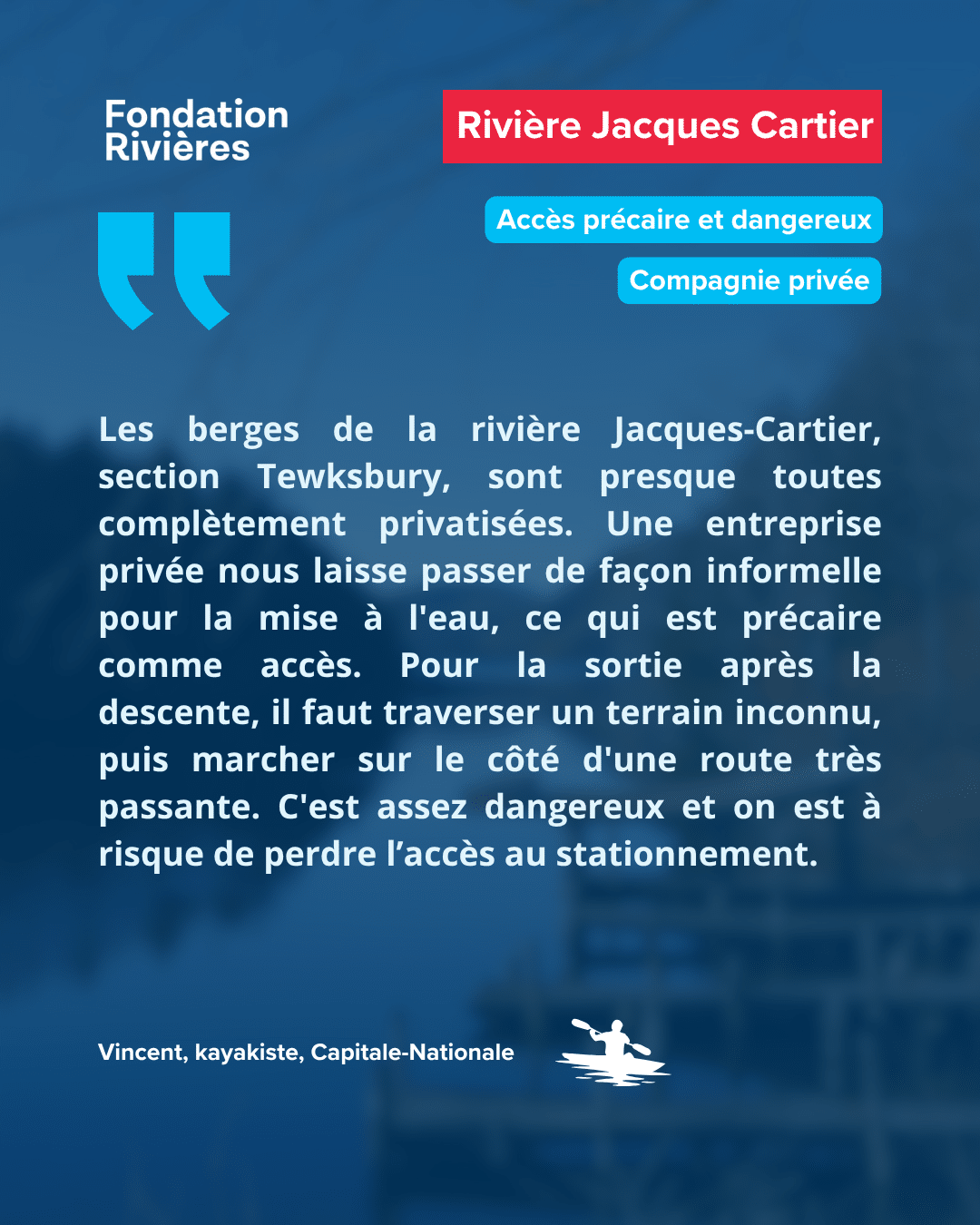
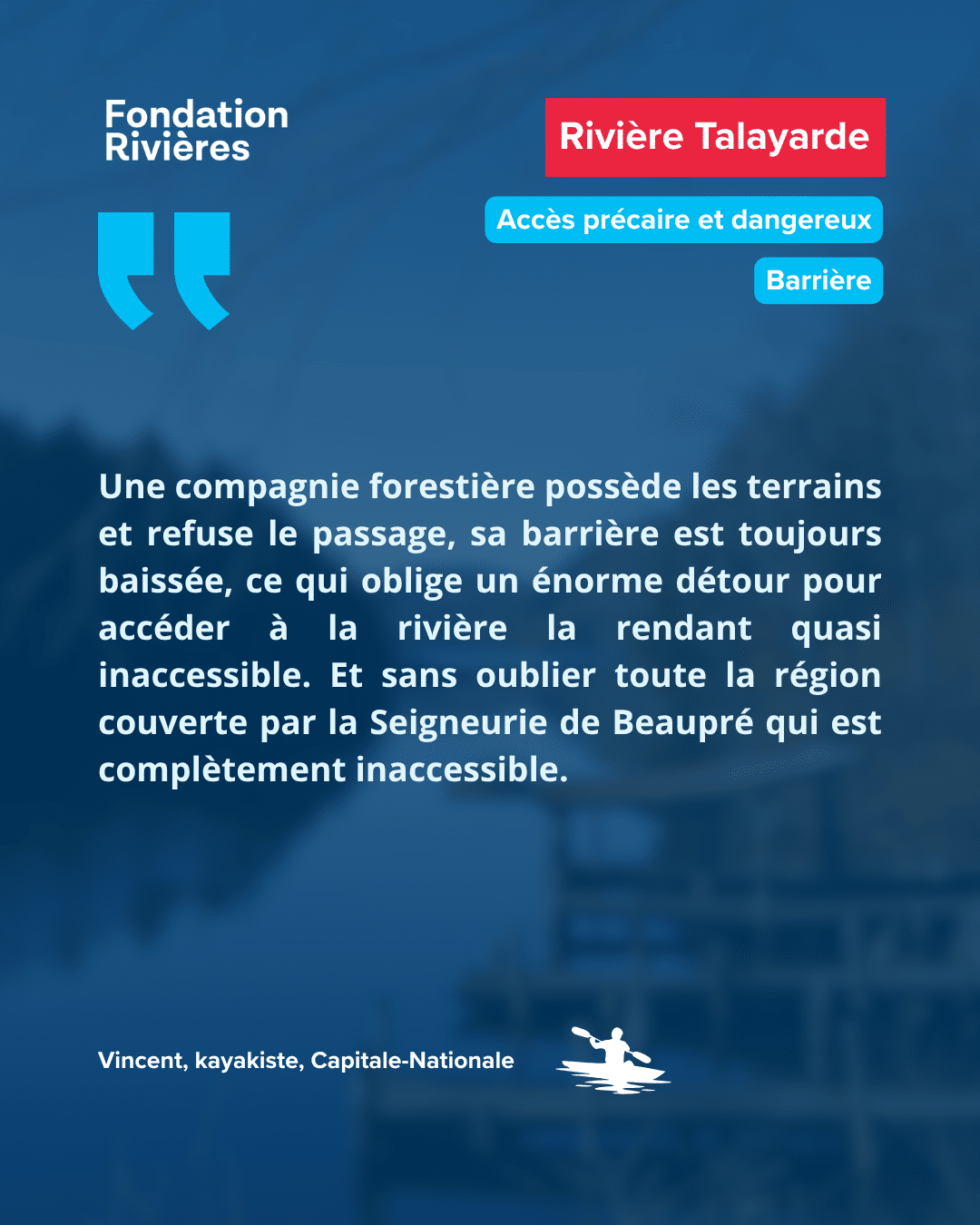
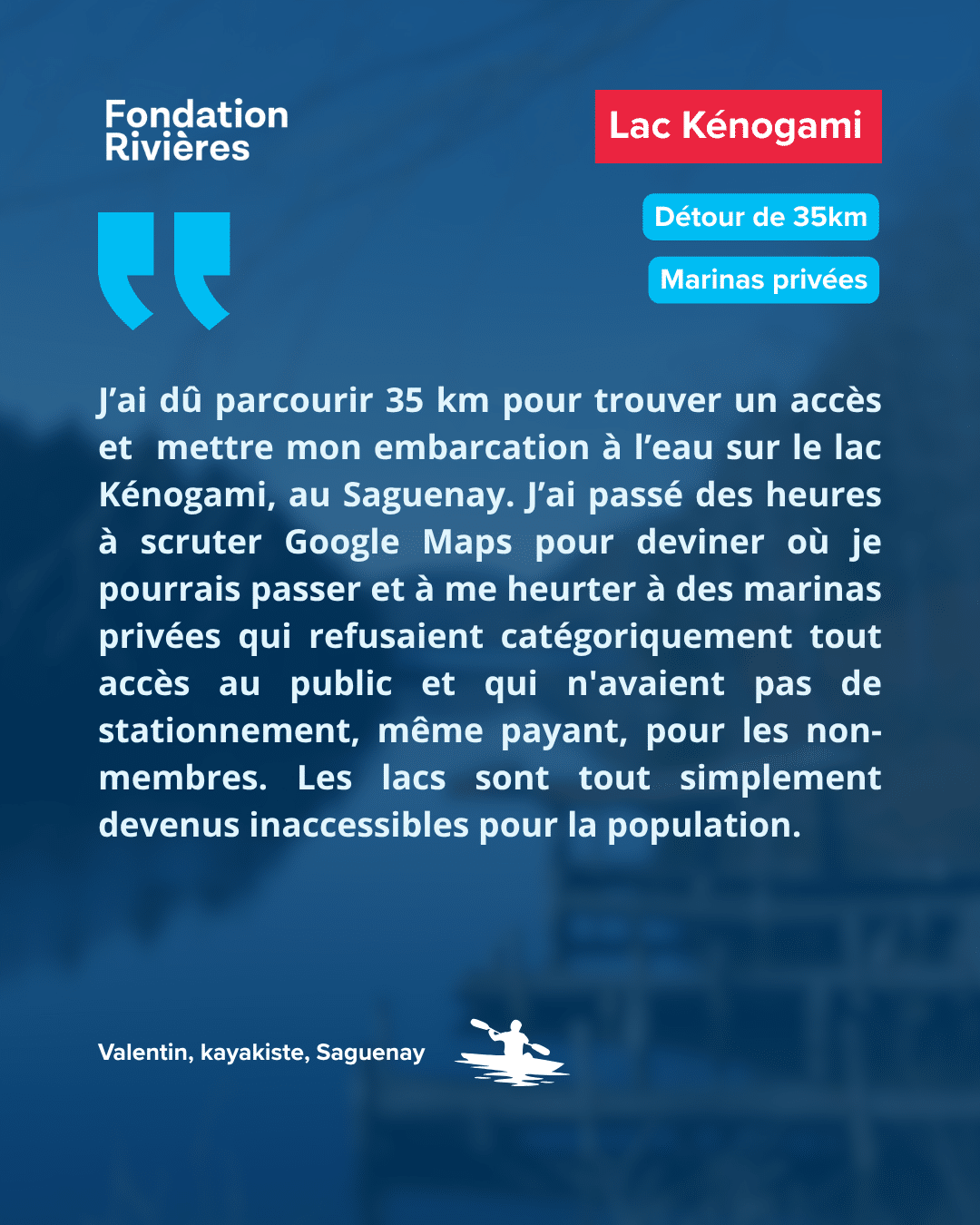
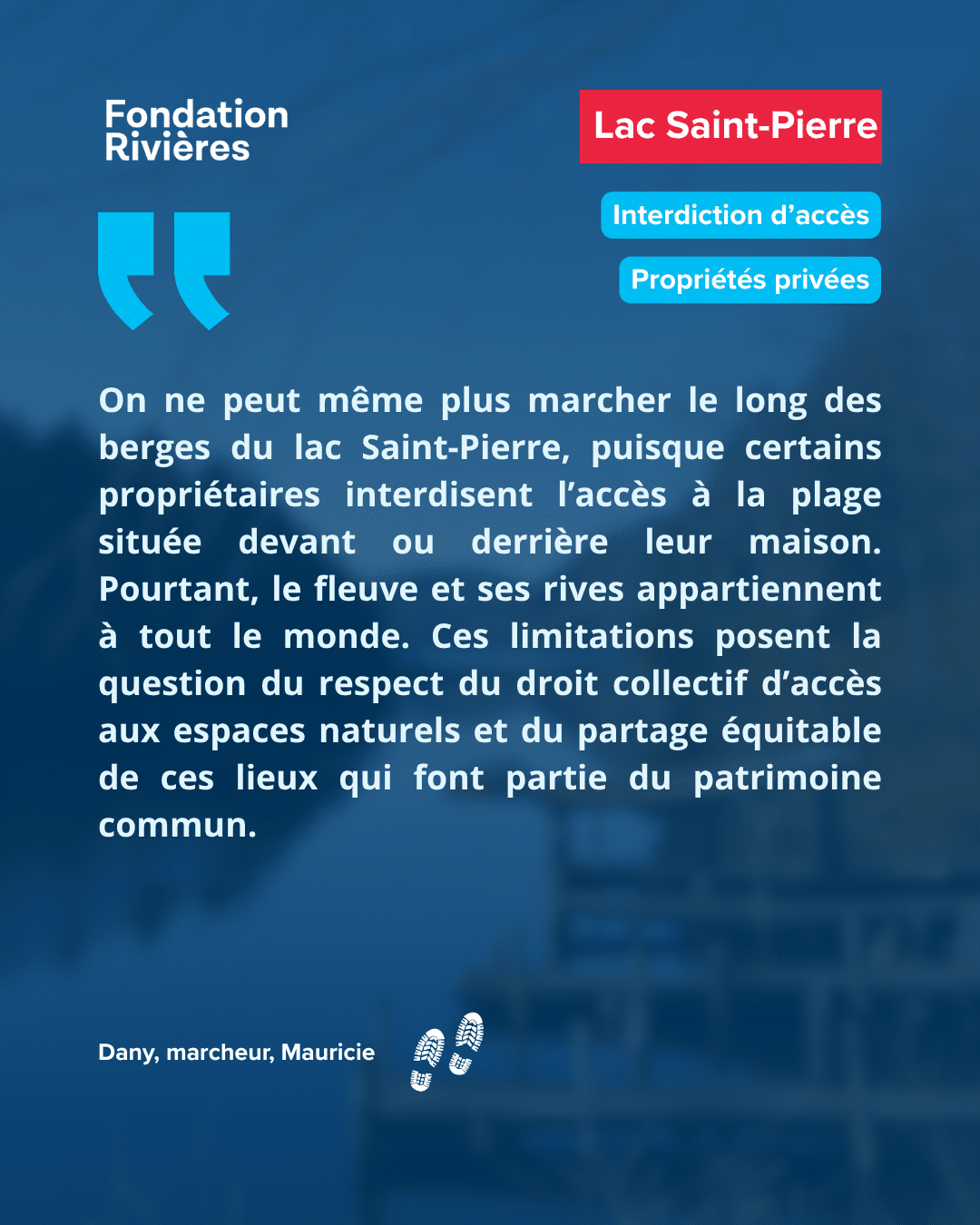
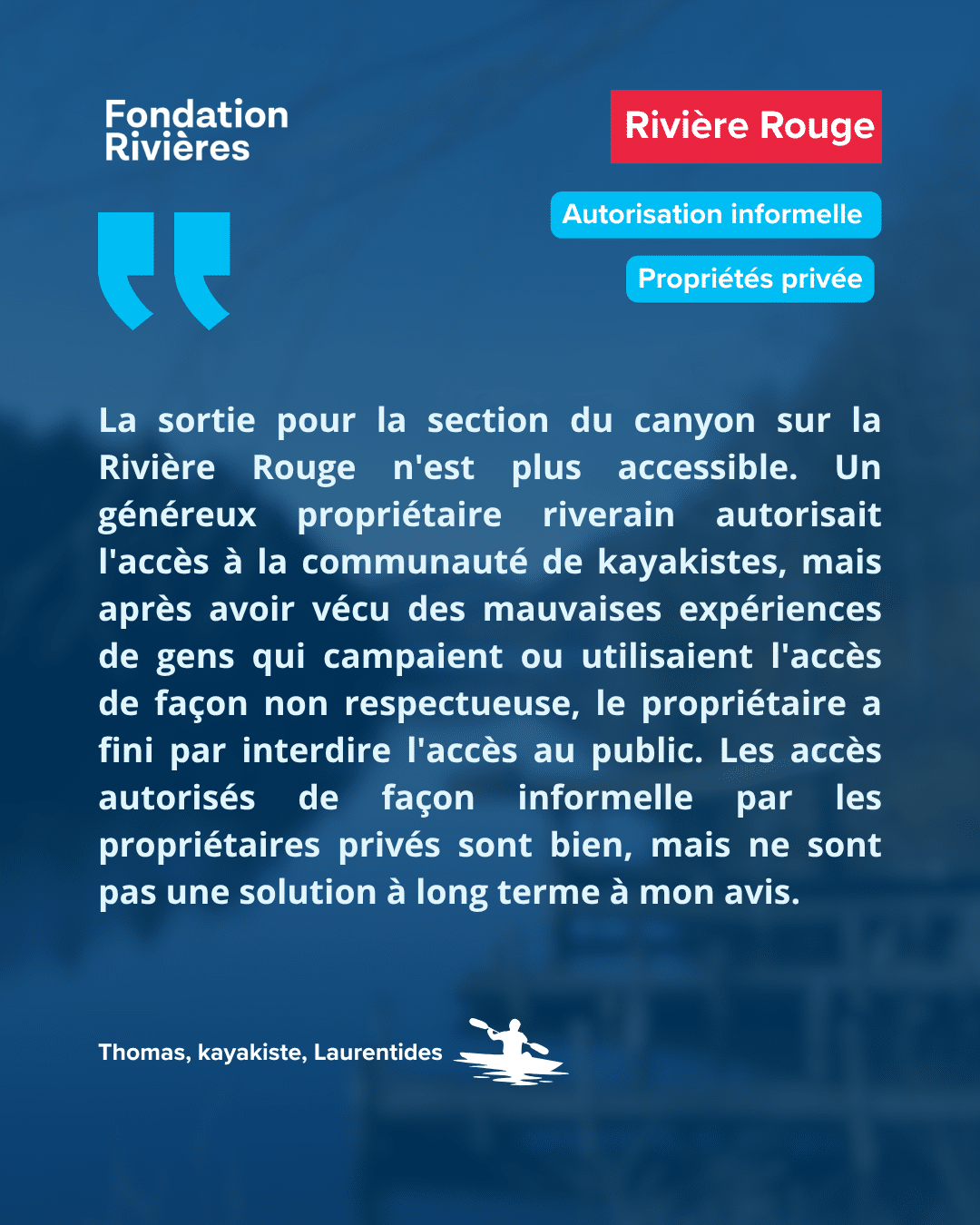
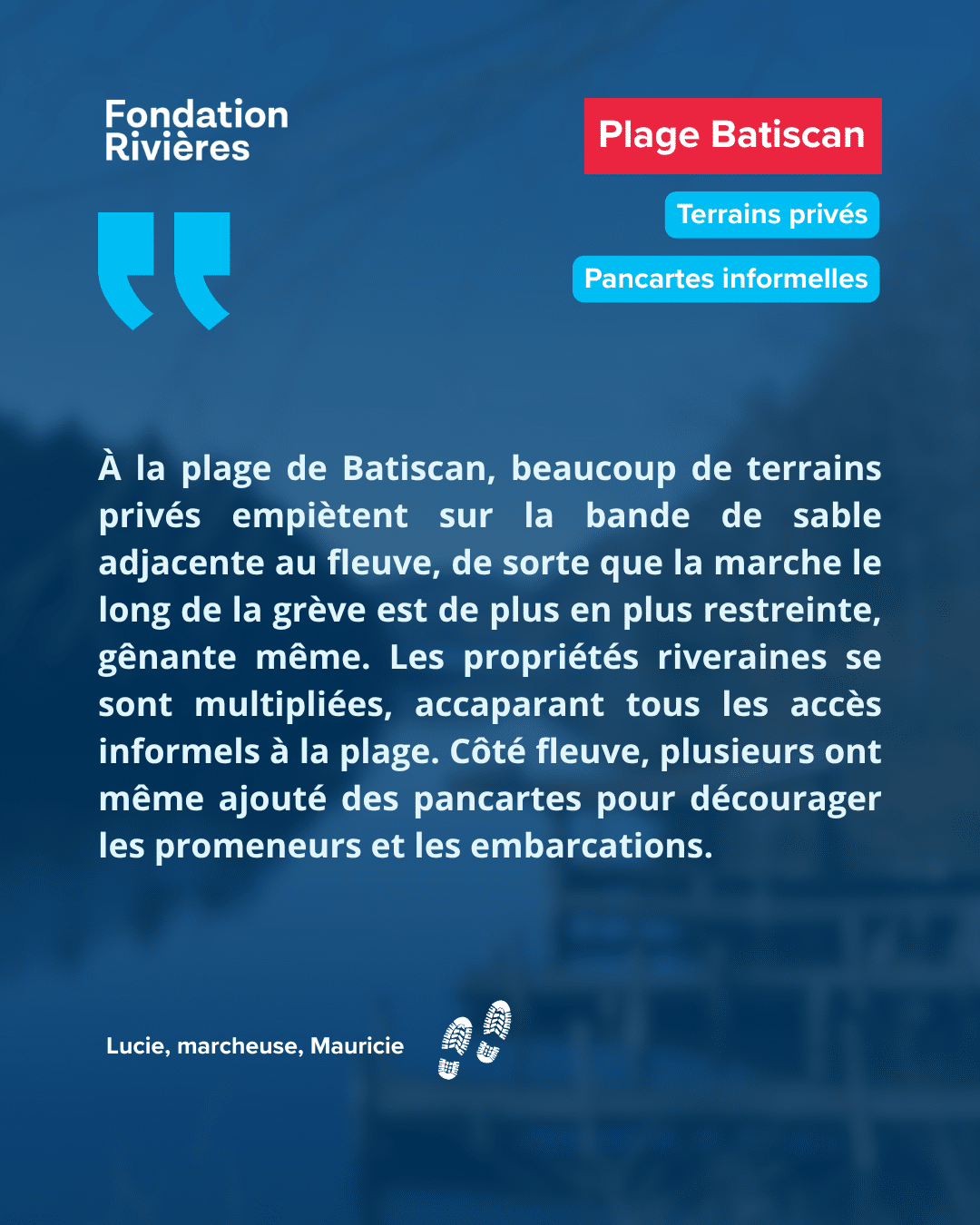
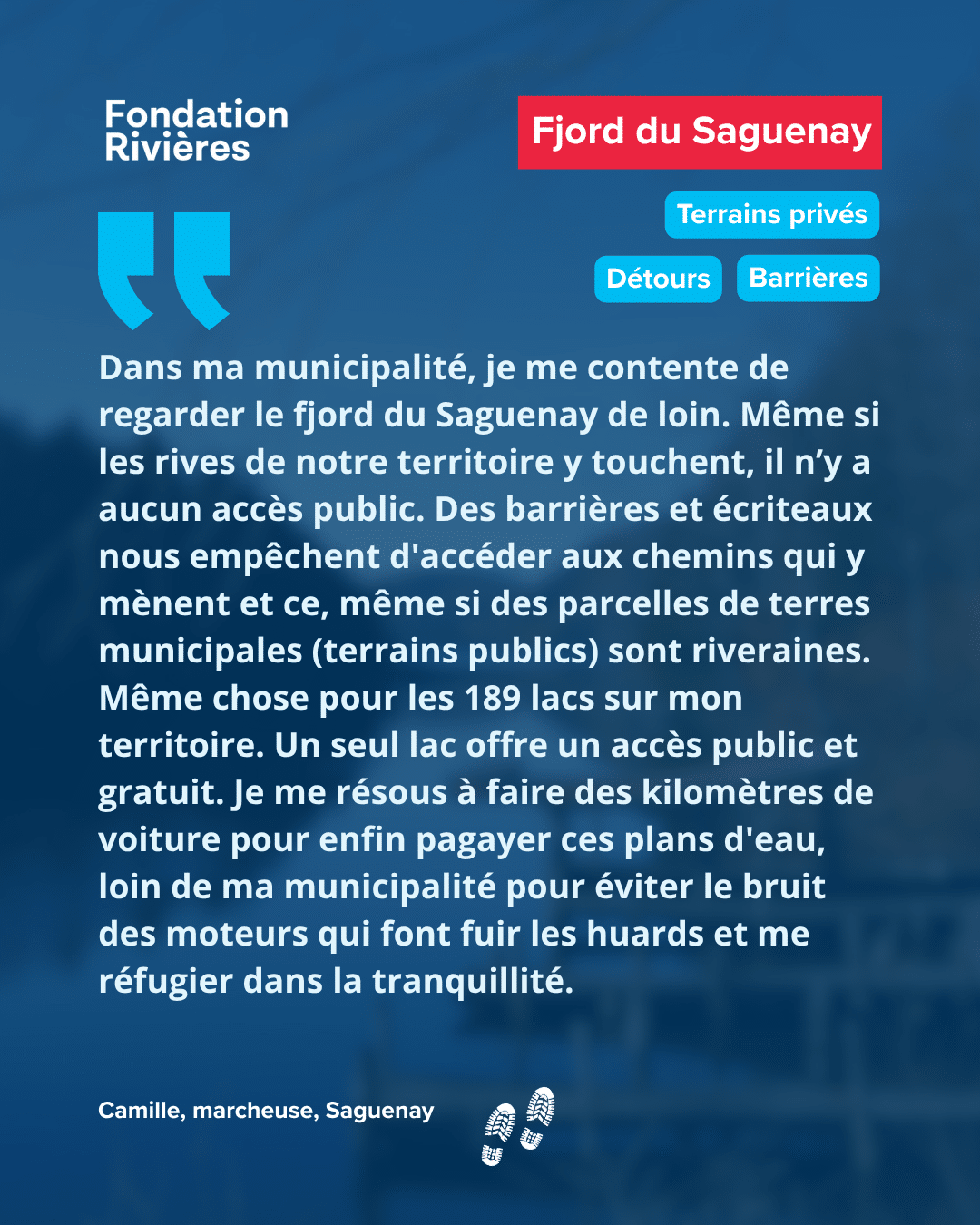
Je n’ai pas accès… parce que je ne suis pas résident
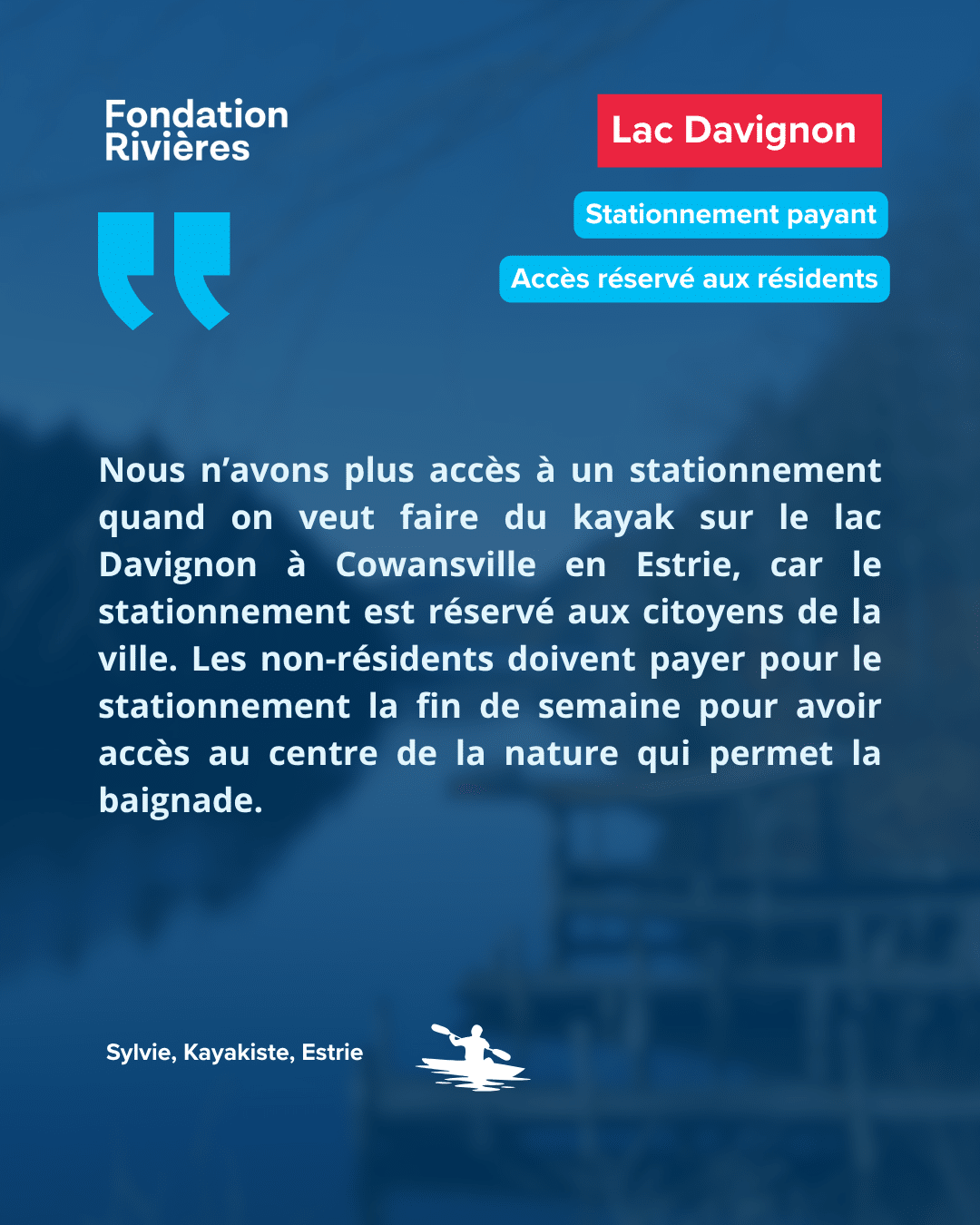
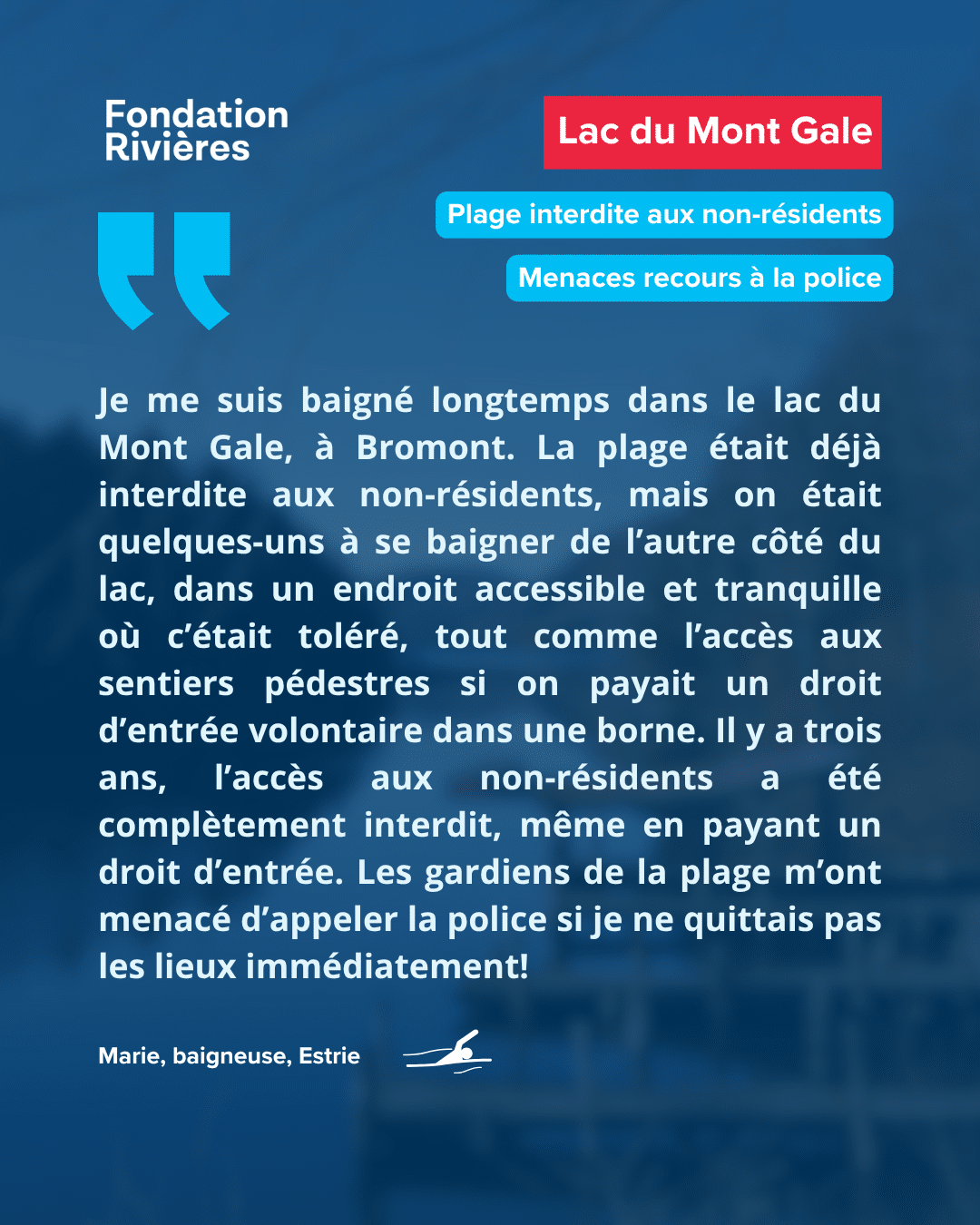
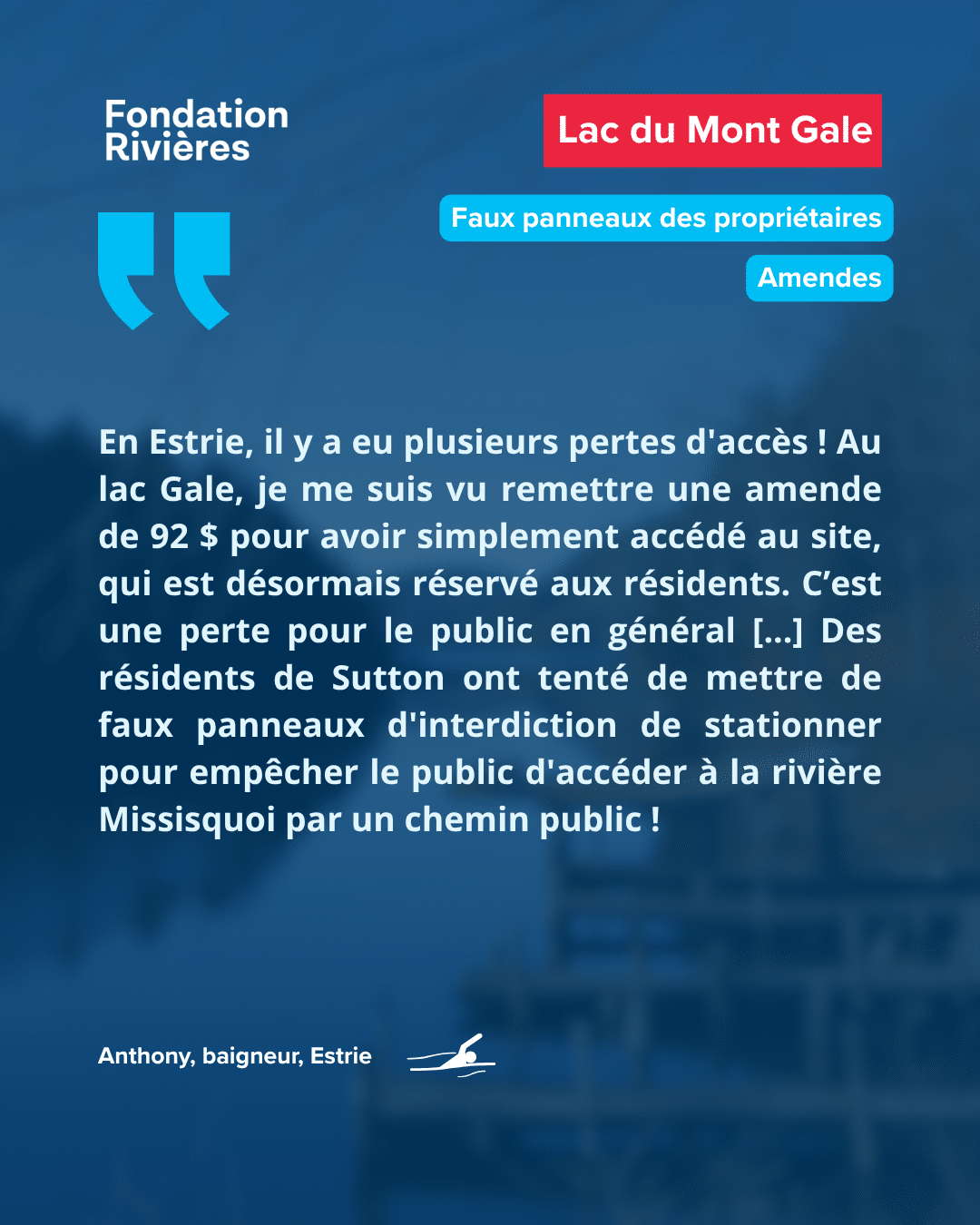
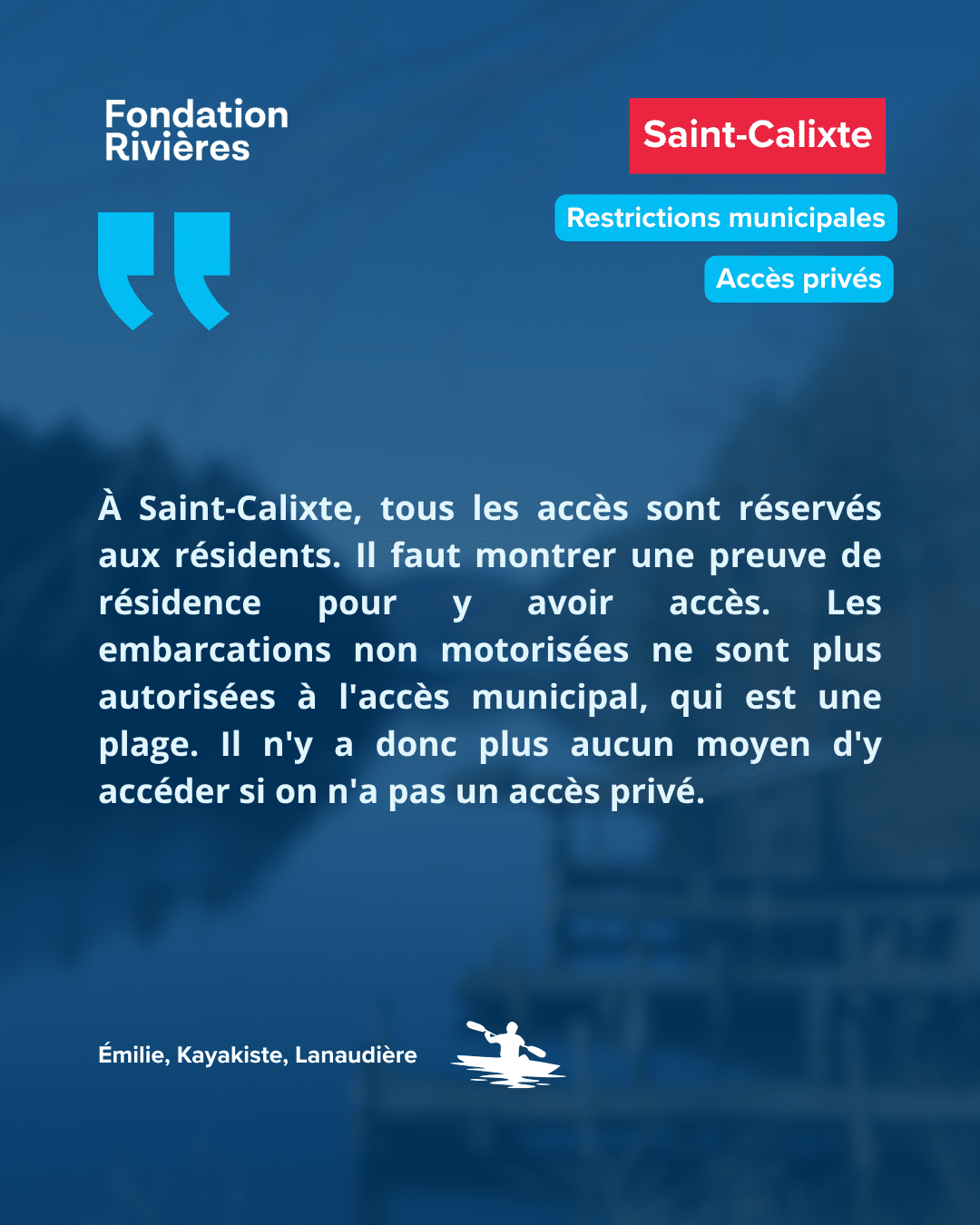
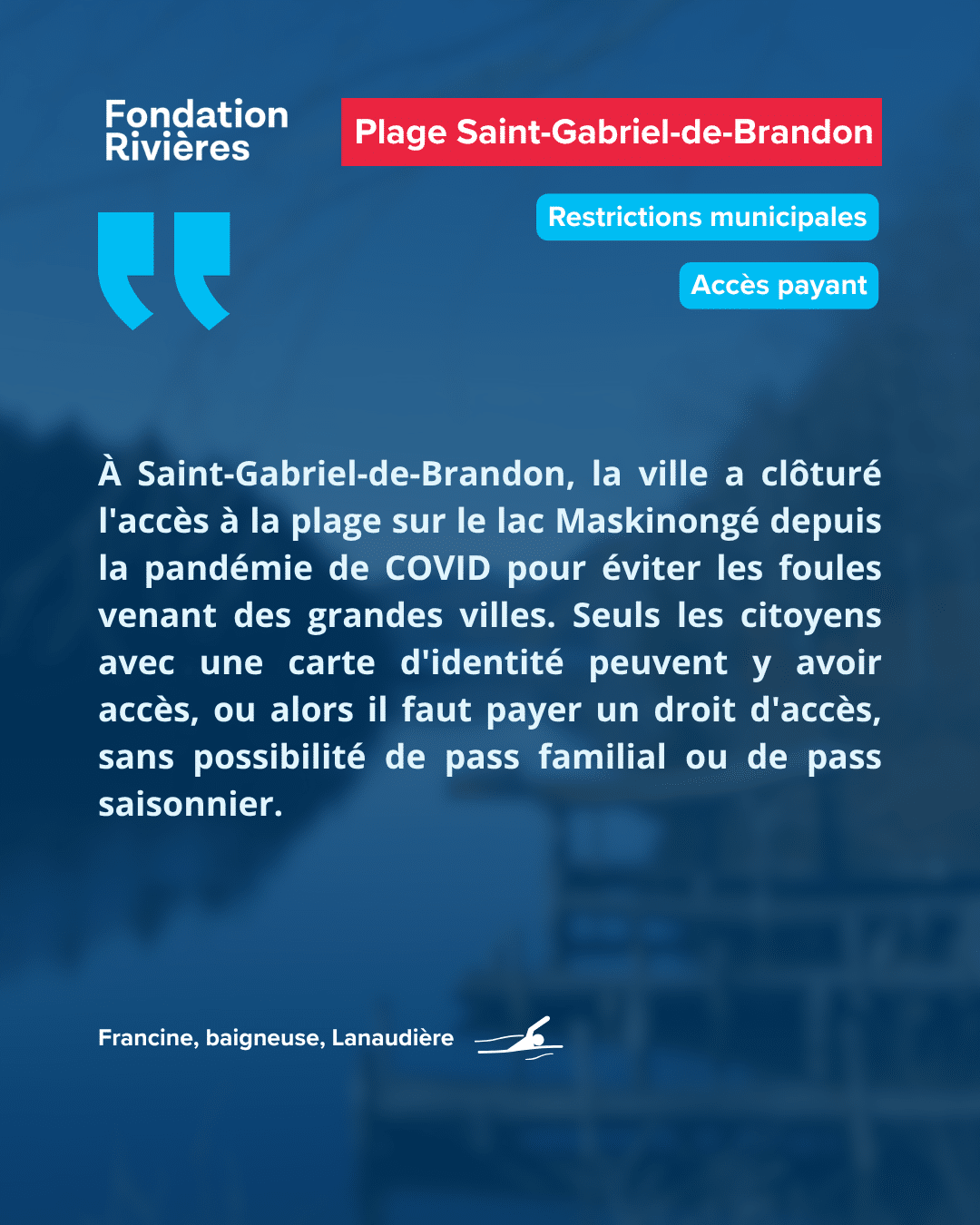
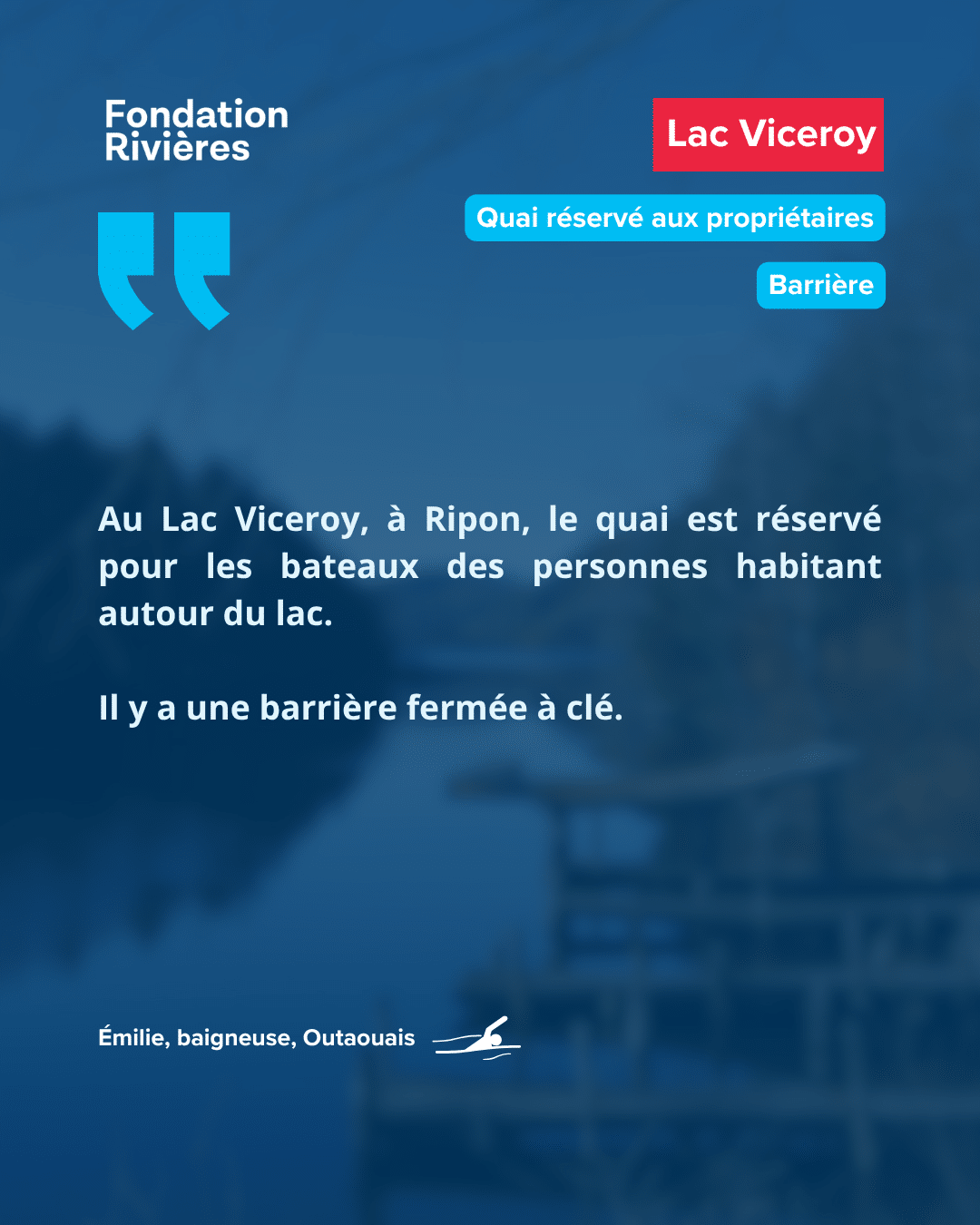
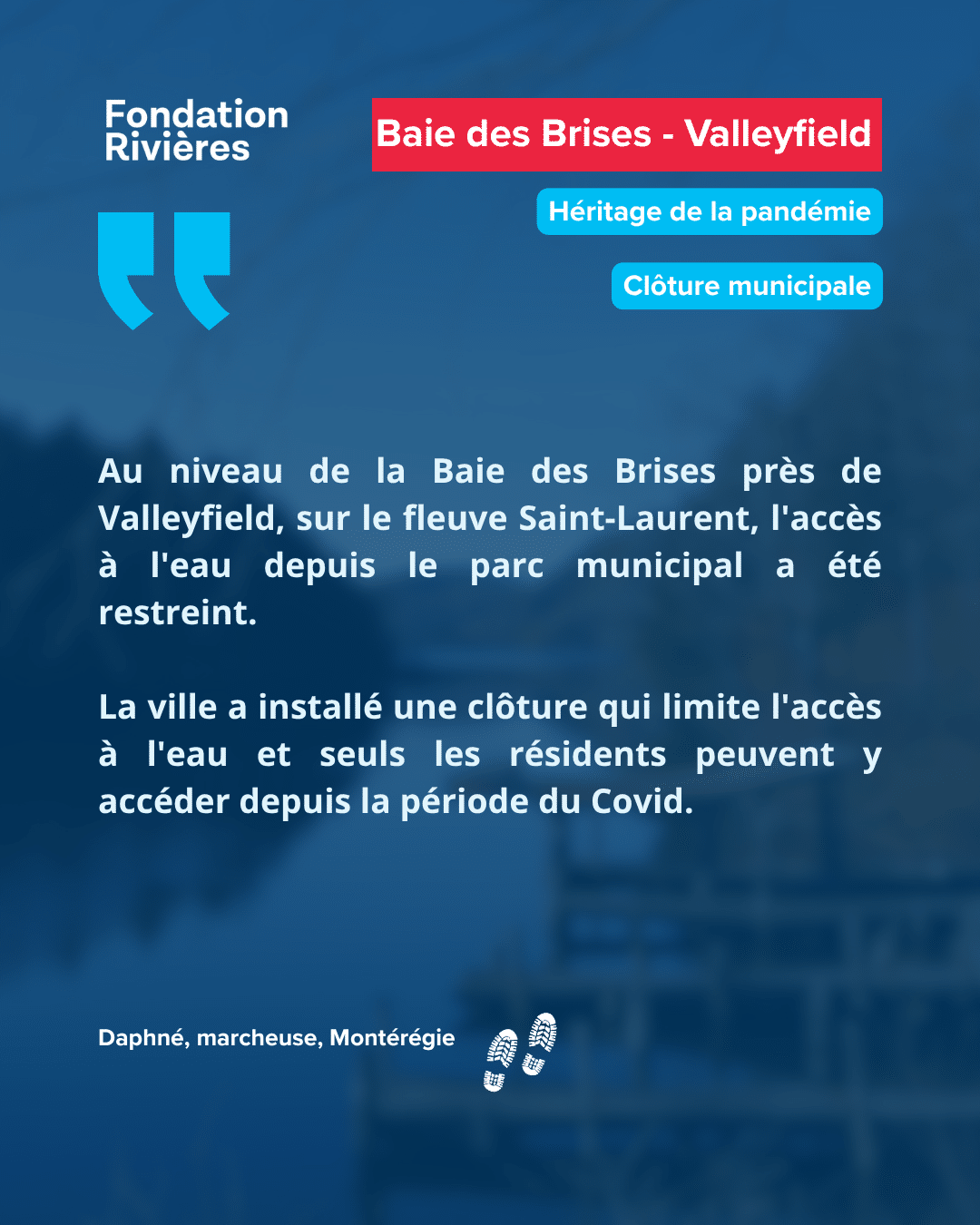
Je dois payer pour avoir accès à la nature
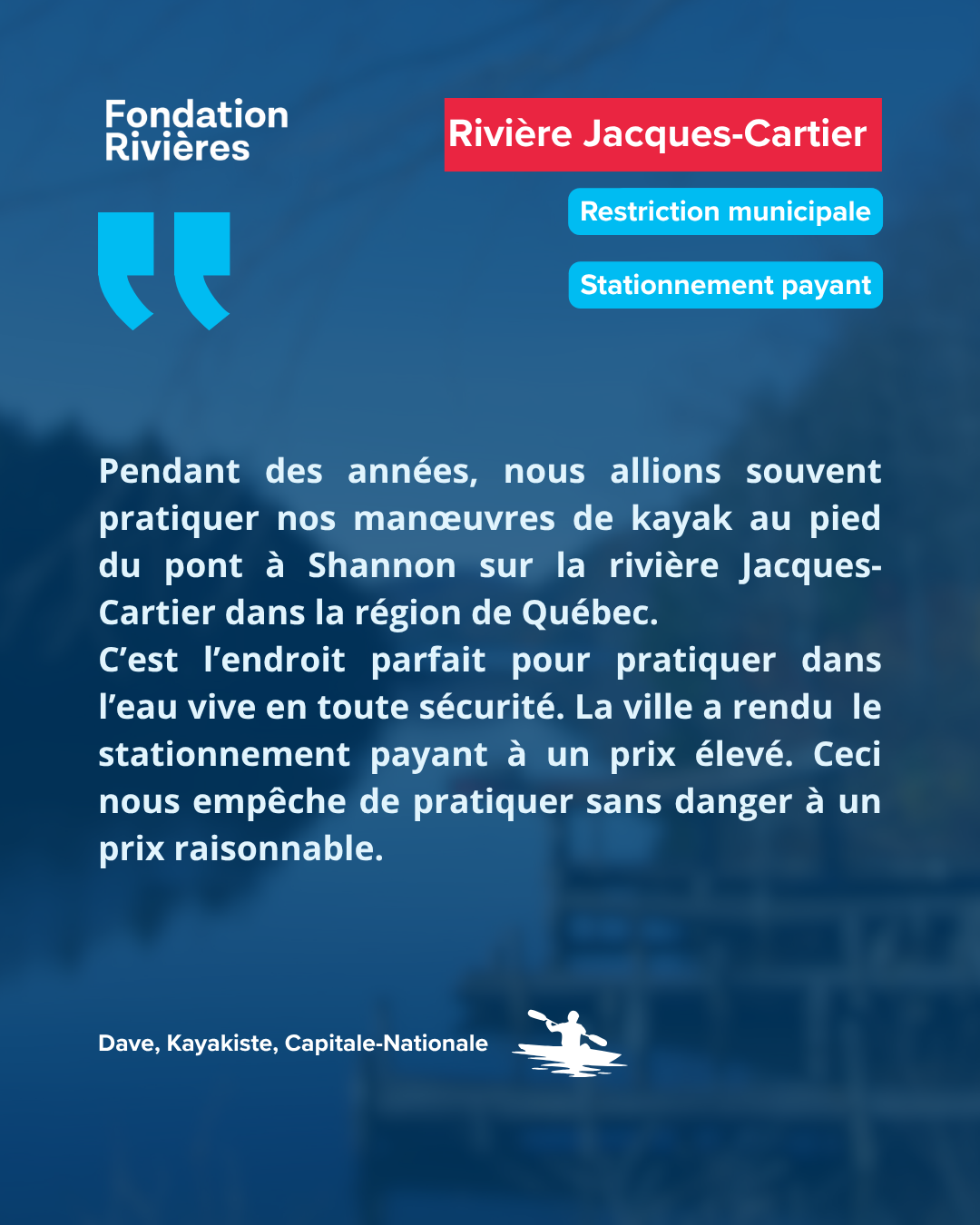
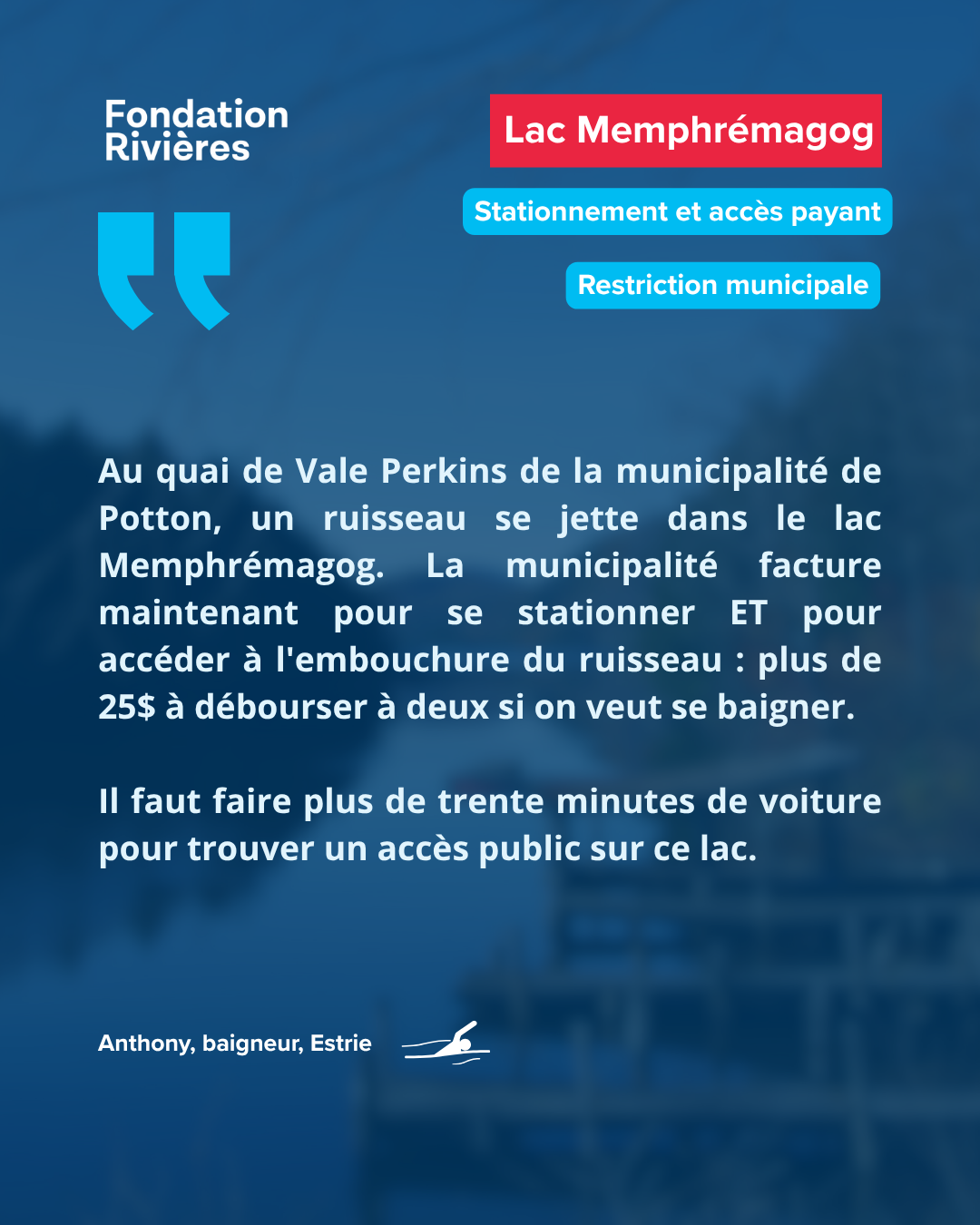
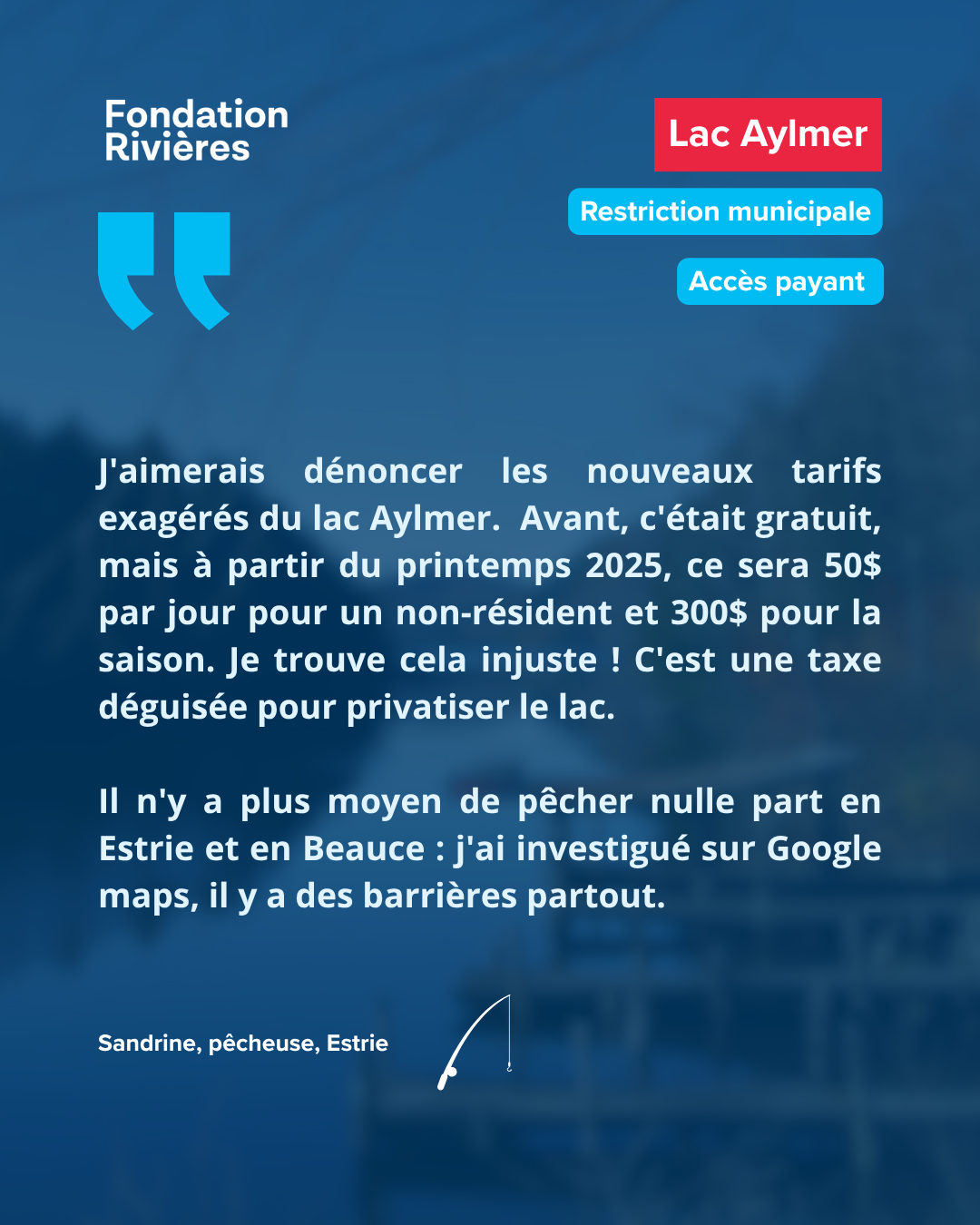
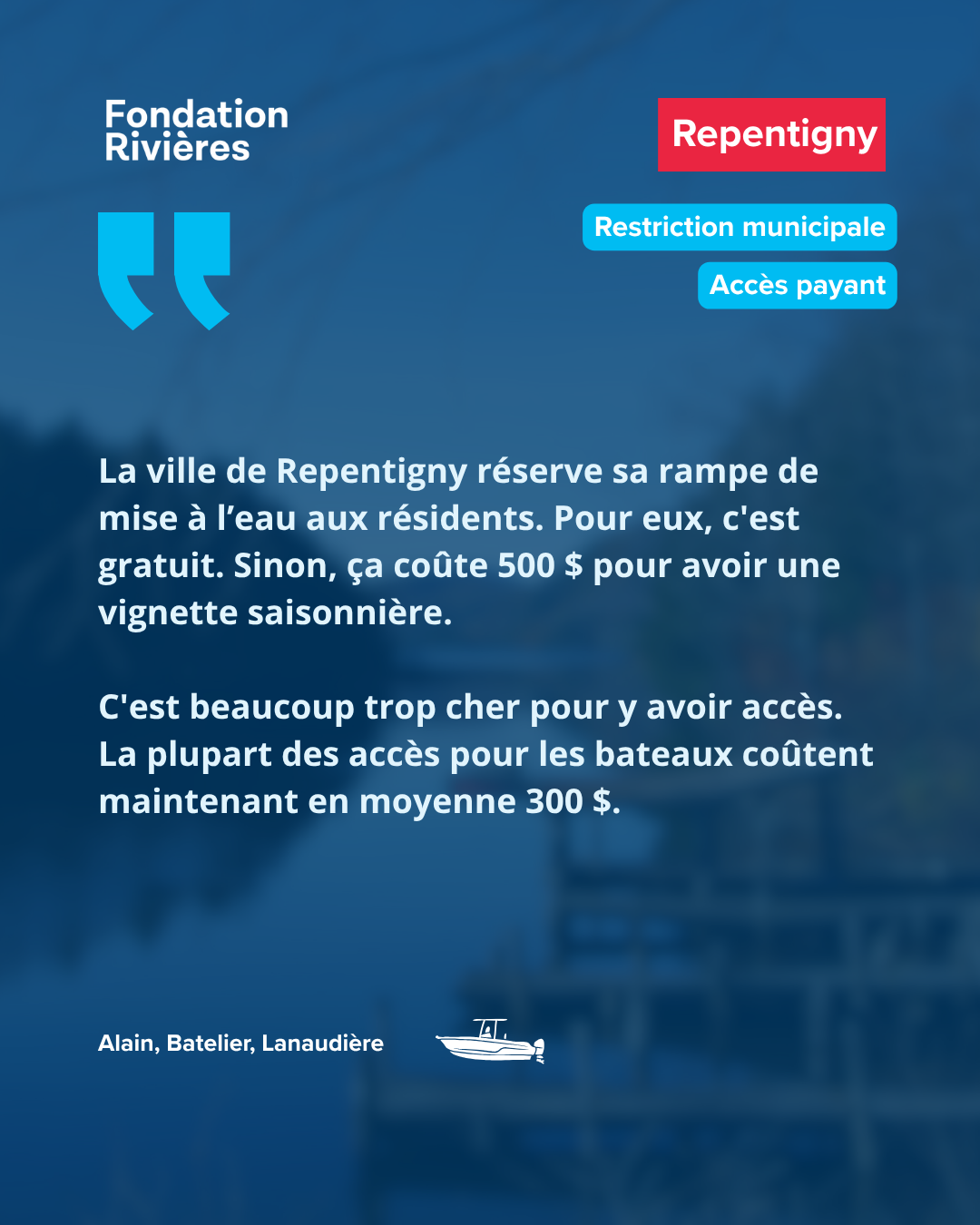
Je me heurte à des interdictions ou à des aménagements inadaptés
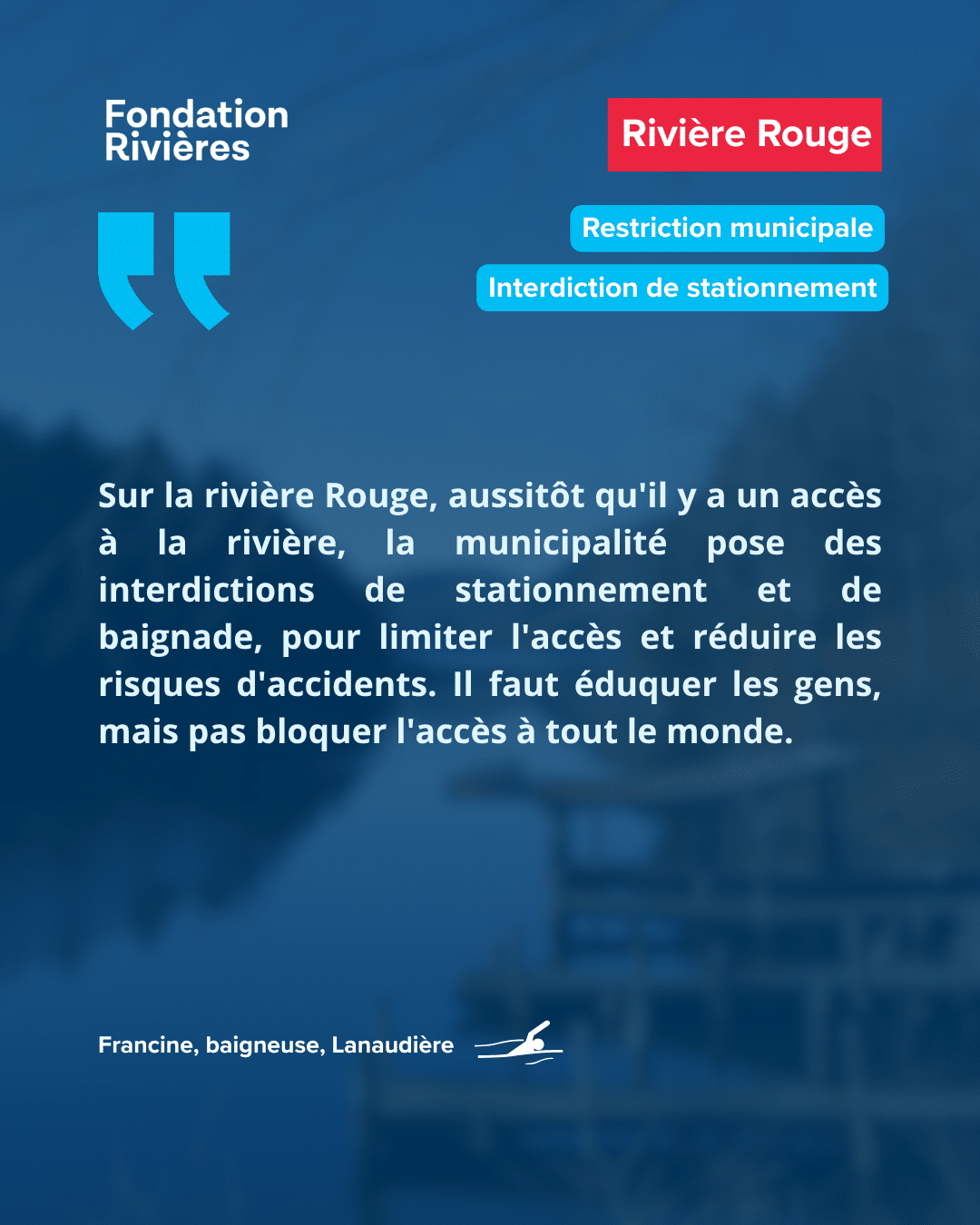
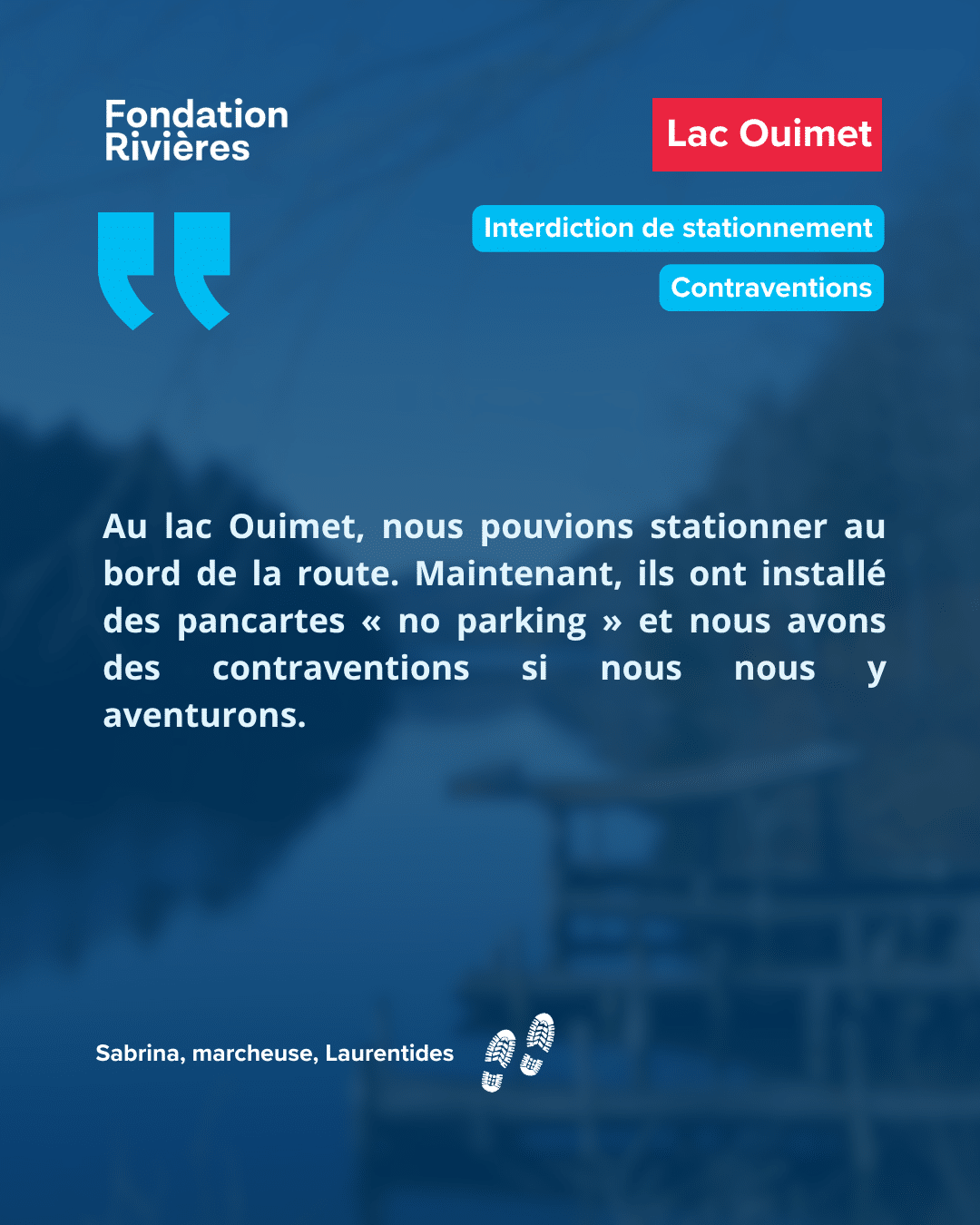
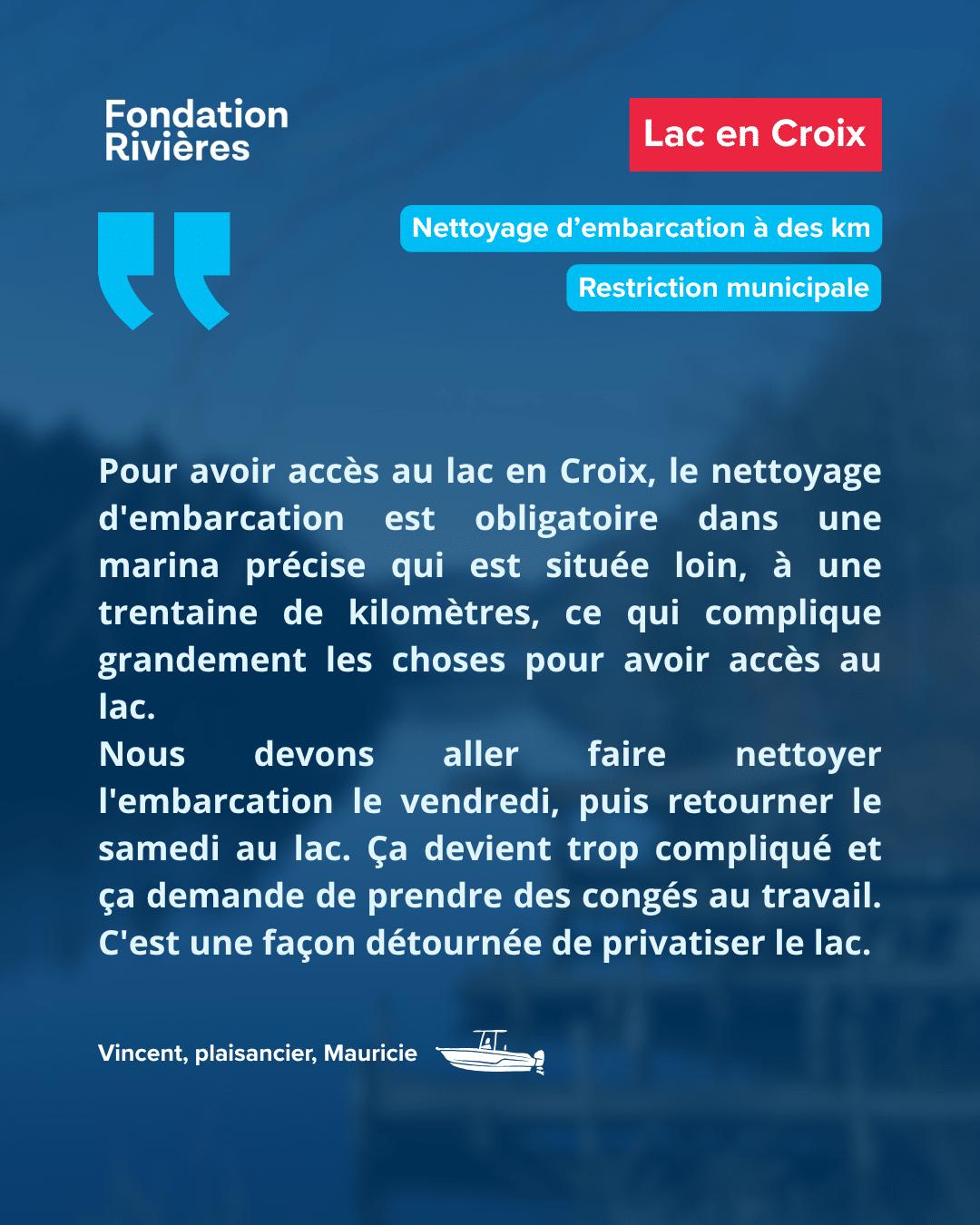
Comment en sommes-nous arrivés-là ?
Même si la Loi sur l’eau reconnaît l’eau comme une ressource qui fait partie du patrimoine commun à tous et qui ne peut faire l’objet d’appropriation, le Code civil du Québec stipule qu’on ne peut en profiter qu’à condition d’accéder légalement. Il précise aussi qu’il est interdit de mettre pied sur la berge (terrain privé), ce qui fait que 98 % des lacs et rivières sont enclavés et réservés exclusivement aux propriétaires riverains. Visionnez la vidéo (contenu à venir) et parcourez notre encadré « En bref » pour saisir les principaux enjeux.


Ce qu'il faut retenir en bref :
- Des protections historiques abandonnées en 1987 :
La « réserve des trois chaînes » est un mécanisme institué par le régime anglais qui permettait à l’État de conserver une bande de 60 mètres de large au moment de vendre des terres qui bordent les cours d’eau non-navigables et flottables. Au fil du temps, les chalets se multiplient et les propriétaires empiètent sur ces zones protégées, souvent sans conséquence. Dans les années 1970, on estime à 100 000 le nombre de ces empiètements. Plutôt que d’appliquer le règlement et d’entamer des recours juridiques, le gouvernement choisit d’abolir la réserve des trois chaînes en 1987. L’Ontario a choisi de conserver cet outil, malgré le grand nombre d’empiètements.
- Permis sur le rivage, interdit sur la berge… mais où tracer la limite?
Les rives des lacs et rivières sont presque toutes publiques, puisqu’elles appartiennent au gouvernement du Québec. Elles sont une continuation du lit de la rivière et ce, jusqu’à la ligne des hautes eaux qui est le point le plus élevé où l’eau touche la terre ferme, sans inondation. Cette ligne sert de démarcation entre un terrain privé et le domaine public et elle est dynamique, en ce sens qu’elle bouge dans le temps s’il y a de l’érosion ou une accumulation de sédiments. Pour être officiellement reconnue, cette ligne doit être délimitée par un arpenteur-géomètre, un processus coûteux. L’utilisation de la ligne des hautes eaux comme démarcation favorise la discorde et les recours aux tribunaux qui ont tendance à donner le bénéfice du doute aux propriétaires. Trop souvent, c’est au public d’engager les frais et les recours pour démontrer le contraire.
- Les droits des propriétaires ouvrent la porte à des abus :
L’article 920 du Code civil du Québec précise qu’il faut respecter les droits des propriétaires sans donner de paramètres précis. Certaines municipalités en abusent et vont accuser de flânage une personne qui déambule sur le rivage ou invoquer une promiscuité excessive pour empêcher quelqu’un d’accoster son embarcation quelques minutes sur un banc de sable devant un terrain privé.
- Servitudes et responsabilité civile: un casse-tête pour les propriétaires de bonne volonté :
Les propriétaires peuvent donner une autorisation à long terme ou spontanée (une seule fois), verbale ou écrite, à une personne ou un groupe de personnes de traverser leur terrain pour accéder à la rive. Malheureusement, si quelqu’un se blesse en marchant de par sa propre négligence, rien ne l’empêche de poursuivre le propriétaire en responsabilité civile. Ailleurs dans le monde, on a balisé ces recours qui ne sont possibles que si le propriétaire a délibérément cherché à nuire à la personne (ex: en installant un tapis de clous ou un piège à ours sur le sentier).
- Des freins appliqués par les municipalités :
Il y a si peu d’accès public aux berges que cela entraîne un surachalandage dans certaines régions et des municipalités imposent des tarifs excessifs ou adoptent des règlements qui réservent les accès publics aux résidents, voire interdisent le stationnement. Ces mécanismes dissuasifs viennent limiter encore plus l’accès aux berges des lacs et rivières.
Des solutions existent. Appliquons-les.
Les États-Unis, l’Écosse, la France, la Nouvelle-Zélande et les pays scandinaves ont mis en place des solutions simples et réalistes qu’on pourrait facilement adapter au contexte québécois.
Naviguez entre ces deux blocs de solutions pour en apprendre davantage et défilez notre carrousel pour découvrir ce que font la France, les États-Unis, l’Écosse, et la Nouvelle-Zélande pour s’adapter à notre réalité québécoise.
Des solutions pour relever deux grands défis
Ce que les autres pays nous apprennent:
🇫🇷 France
- Si un accès disparaît, les autorités sont obligées de garantir l’ouverture d’un nouvel accès public équivalent
- Zones de passage obligatoire sur l’ensemble du territoire qu’il soit public ou privé
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
- Si un terrain public est vendu au privé, une portion de 20 mètres est conservée pour assurer l’accès
- Obligation pour les entreprises privées internationales d’assurer un accès.
🇺🇸 États-Unis
- Les pouvoirs publics sont obligés de garantir l’accès à la nature aux citoyens
- Ententes possibles avec les propriétaires privés
🏴 Écosse
- L’Écosse était dans une situation aussi critique que le Québec avant de redresser la barre en 2003. C’est possible !
- Droit d’accès universel avec code de conduite
Comment agir ?
Vous êtes une municipalité et vous voulez faire parti de la solution ?
Contactez-nous
Inscrivez-vous à notre infolettre
pour rester informé des actions à venir
Retrouvez toutes nos ressources !
- Téléchargez notre rapport complet sur le sujet
- Rendez-vous sur le projet de recherche « L’accès public à l’eau et l’enclavement du domaine hydrique de l’État»
- Retrouvez l’ensemble articles sur les accès aux berges :

98% des lacs sont inaccessibles: la Fondation Rivières propose des solutions
Montréal, le 18 juin 2025 – On estime qu’au moins 98% des lacs et rivières du sud du Québec sont

Cohabitation durable sur la rivière Richelieu : une vision forte et un plan de match clair
La Fondation Rivières vient de compléter une concertation d’envergure pour la protection de la rivière Richelieu, en collaboration avec l’organisme

Grande Descente 2024 : Plus de 200 participants pour la Journée Mondiale des Rivières
Le 22 septembre dernier, à l’occasion de la journée mondiale des rivières, plus de 200 personnes, de tous âges, ont