L’urgence actuelle est de conserver les rares accès existants. Nous proposons plusieurs pistes de solution en ce sens :
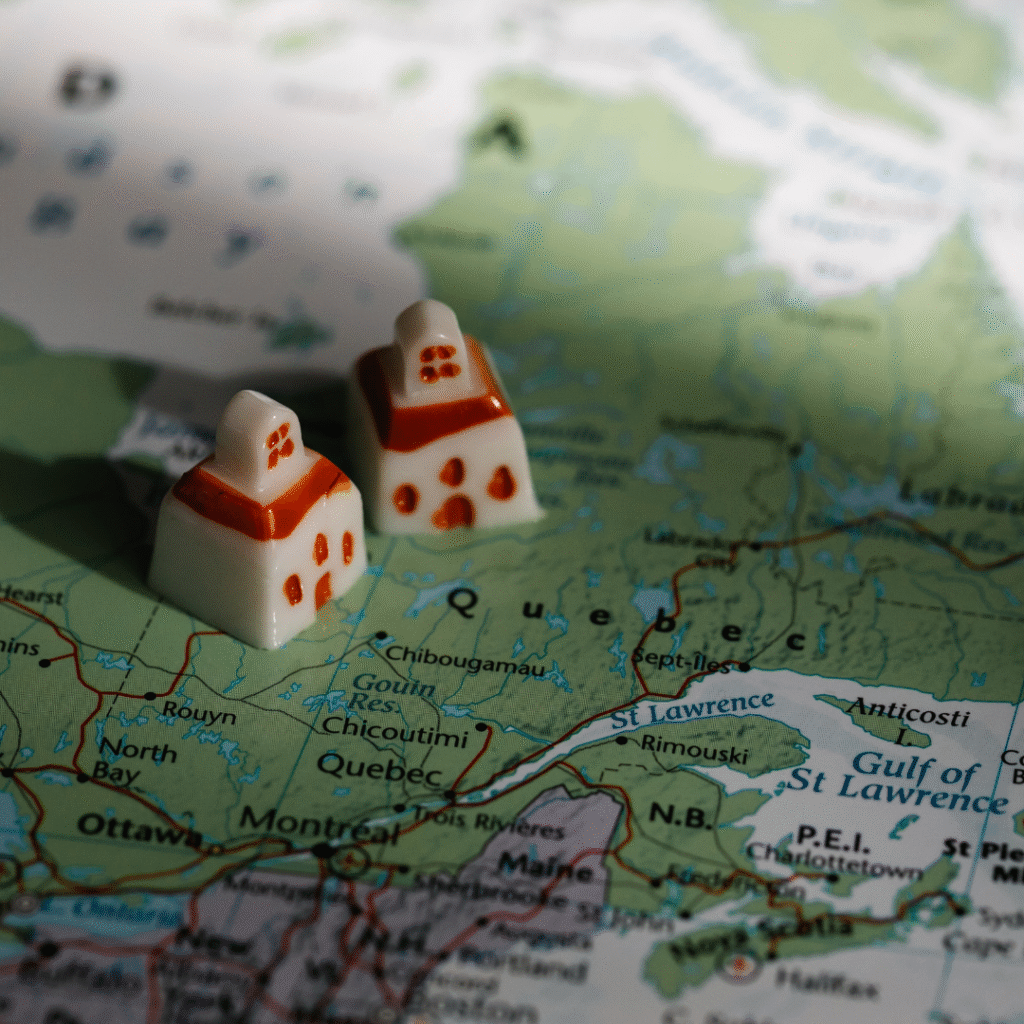
En France, l’acteur local responsable d’une perte d’accès (par exemple les municipalités ou les promoteurs immobiliers) a une obligation de compensation. Ainsi, si un nouveau développement voit le jour sur des berges ou si une terre publique riveraine devient privée, l’organisme responsable de cette perte d’accès a l’obligation de trouver un autre accès équivalent sur le même lac ou la même rivière.
Nous recommandons que cette mesure soit appliquée au Québec et que cette obligation ne puisse pas être remplacée par une compensation tarifaire.
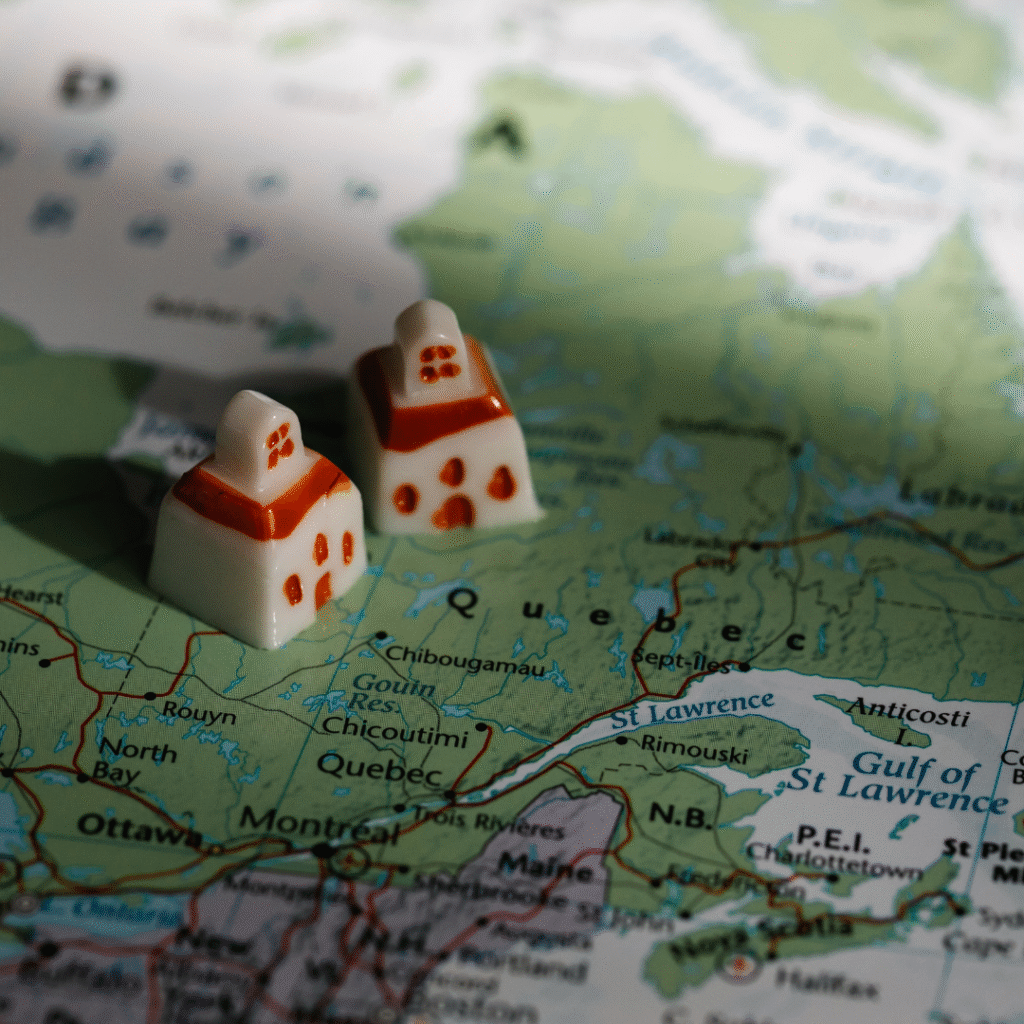
En France, l’acteur local responsable d’une perte d’accès (par exemple les municipalités ou les promoteurs immobiliers) a une obligation de compensation. Ainsi, si un nouveau développement voit le jour sur des berges ou si une terre publique riveraine devient privée, l’organisme responsable de cette perte d’accès a l’obligation de trouver un autre accès équivalent sur le même lac ou la même rivière.
Nous recommandons que cette mesure soit appliquée au Québec et que cette obligation ne puisse pas être remplacée par une compensation tarifaire.

Il y a si peu d’accès public aux berges que cela entraîne un surachalandage dans certaines régions. En réaction, des municipalités vont imposer des tarifs excessifs ou des règlements qui réservent à toute fin pratique les accès publics à leurs résidents.
Ces mécanismes dissuasifs devraient être interdits ou minimalement encadrés, par exemple en fixant un seuil provincial maximal dans les tarifs journaliers ou saisonniers permettant d’accéder à une plage, une rampe de mise à l’eau, etc.

Il y a si peu d’accès public aux berges que cela entraîne un surachalandage dans certaines régions. En réaction, des municipalités vont imposer des tarifs excessifs ou des règlements qui réservent à toute fin pratique les accès publics à leurs résidents.
Ces mécanismes dissuasifs devraient être interdits ou minimalement encadrés, par exemple en fixant un seuil provincial maximal dans les tarifs journaliers ou saisonniers permettant d’accéder à une plage, une rampe de mise à l’eau, etc.
L’utilisation de la ligne des hautes eaux comme démarcation entre un terrain privé et public est complexe et coûteuse à faire appliquer. Elle favorise la discorde et les recours aux tribunaux.
Le Québec pourrait s’inspirer de la Nouvelle-Zélande et établir que la limite de la rive publique soit située à 20 mètres du plan d’eau, quel que soit le niveau de l’eau.
Une telle règle pourrait s’accompagner d’exceptions pour les régions où l’érosion est un problème majeur (ex. : Gaspésie) ou dans le cas où des bâtiments existants ont été construits trop près du rivage.
On ne peut pas revenir sur les erreurs du passé, mais on peut donner un coup de barre en stimulant la création de nouveaux accès publics et en permettant au public de traverser à pied des terres privées pour accéder aux rivières et aux lacs.

Les municipalités peuvent exiger d’un propriétaire riverain qui demande un permis de lotissement ou de construction qu’il cède une partie du terrain ou qu’il accorde une servitude à la municipalité pour qu’elle puisse aménager un parc ou maintenir un espace naturel, ce qu’on appelle une « contribution aux fins de parcs et d’espaces naturels ».
Ce mécanisme est suggéré dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; il devrait être obligatoire pour les rivières et les lacs d’intérêt récréotouristiques et pour les lacs et les rivières au-delà d’une certaine surface.
Pour encourager les propriétaires à permettre le passage sur leurs terrains, tous les pays que nous avons étudiés ont limité les recours en responsabilité civile contre des propriétaires et gestionnaires de site : ces derniers ne peuvent pas être tenus responsables pour les risques inhérents à la pratique d’une activité (ex. se tordre une cheville en passant sur un chemin pour accéder à un cours d’eau). Ils ne sont évidemment pas protégés s’ils cherchent délibérément à nuire aux utilisateurs (ex. placer un piège à ours pour empêcher le passage).
En contrepartie, les usagers sont considérés comme étant responsables de leurs actes et c’est à eux de doivent prendre les précautions nécessaires à la pratique de leur activité.
Le passage en terres privées est accepté et rendu possible dans plusieurs des pays étudiés :
Le Québec doit s’inspirer de ces pratiques et créer des servitudes obligatoires afin de permettre de traverser à pied une terre privée pour accéder aux rivières et aux lacs d’une certaine taille.
Make a difference for the environment
Become a member of the Foundation by donating. Your contribution allows our team to continue to mobilize to protect Quebec's rivers and waterways for future generations.
Explore